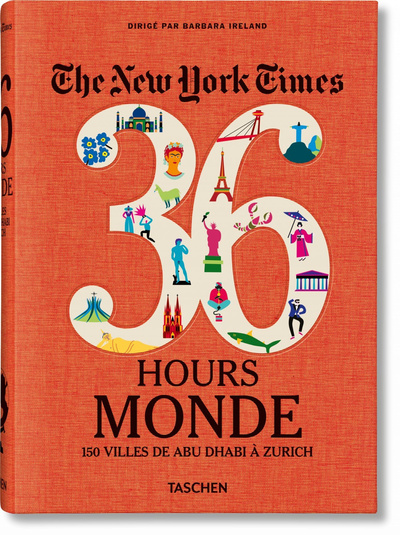
Issues de la chronique du New York Times, les présentations de 150 villes à travers le monde, à visiter en trente-six heures.
EAN :
9783836575348
Contient :
763 p. ; 24 x 17 cm
Sujet nom commun :
Message d'information
| Site | Public visé | Cote | Particularité | Situation | Code-barres |
|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque départementale | Adulte | 910.202 NEW | Aucune | Disponible | 6454120067 |
