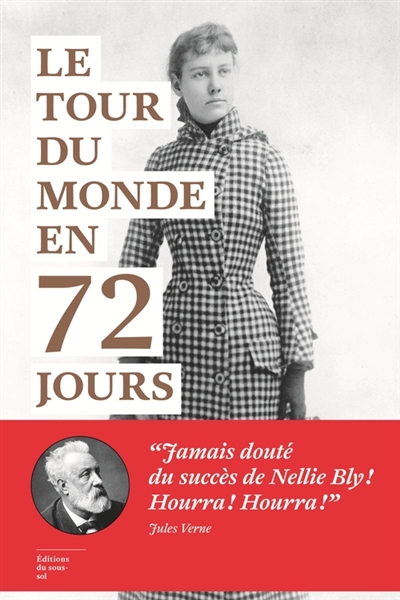
Le tour du monde en 72 jours
Livre
Paris : 2016, Ed. du sous-sol
Collection :
Feuilleton non-fiction
Le récit du tour du monde effectué par la journaliste en 1889 dans une tentative réussie pour battre le record fictif du héros de Jules Verne.
EAN :
9782364681354
Contient :
1 vol. (172 p.) ; 21 x 14 cm
Sujet nom commun :
Sujet géographique :
Sujet nom :
Genre :
Message d'information
| Site | Public visé | Cote | Particularité | Situation | Code-barres |
|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque départementale | Adulte | 910.41 BLY | Aucune | Disponible | 6321010067 |
